Les réponses aux questions courantes
L’aide sociale à l’hébergement est une aide qui peut être versée par le conseil départemental aux personnes ayant des ressources inférieures au montant des frais d'hébergement en établissement.
Le conseil départemental paie la différence entre le montant de la facture de l’établissement et la contribution de la personne, voire de ses obligés alimentaires.
Les montants d’ASH versés par le conseil départemental peuvent être récupérés du vivant et au décès de la personne bénéficiaire.
Pour bénéficier de l’ASH (aide sociale à l'hébergement), il faut :
- avoir plus de 65 ans (ou plus de 60 ans si l’on est reconnu inapte au travail),
- résider en France de façon stable et régulière ou disposer d’un titre de séjour en cours de validité,
- avoir des ressources inférieures au montant des frais d'hébergement.
L’ASH peut être accordée pour un hébergement :
- en résidence-autonomie (ex-logement-foyer),
- en EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes),
- en USLD (unité de soins de longue durée).
Pour que l’ASH soit accordée, il faut que ces établissements disposent de places habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
Le conseil départemental paie la différence entre le montant de la facture de l’établissement et la contribution de la personne, voire de ses obligés alimentaires.
Les montants d’ASH versés par le conseil départemental peuvent être récupérés du vivant et au décès de la personne bénéficiaire.
La PCH et l'APA ne sont pas cumulables. Les personnes éligibles aux deux aides ont, à tout moment, un droit d’option entre la PCH et l’APA. Cela signifie que, à partir de 60 ans, les personnes qui remplissent les conditions pour prétendre à l’APA peuvent choisir entre le maintien de la PCH ou le bénéfice de l’APA lors du renouvellement de leur droit.
De la même façon, une personne bénéficiaire de l’APA peut prétendre à la PCH si sa situation répondait aux critères d’ouverture du droit à la PCH avant 60 ans.
En cas de perte d’autonomie, l’APA à domicile aide à payer les dépenses nécessaires pour faciliter la vie à domicile. Pour faire une demande d’APA à domicile, le formulaire Demande d’aides à l’autonomie à domicile est à remplir. Il s’agit du même formulaire quel que soit le département où vous habitez. Selon votre département de résidence, la demande peut se faire par un formulaire papier et/ou en ligne.
Le formulaire Demande d’aides à l’autonomie à domicile vous permet de faire une demande d’APA à domicile.
Selon votre département de résidence, la demande peut être transmis au conseil départemental :
- soit en envoyant par courrier le formulaire papier de demande d’aide à l’autonomie,
- soit en envoyant de manière dématérialisée le formulaire sur le service en ligne.
Après avoir envoyé le dossier complété, un rendez-vous sera fixé avec l’équipe médico-sociale du conseil départemental à votre domicile pour faire l’évaluation de vos besoins et de votre niveau de perte d’autonomie.
Il existe deux types d’APA :
- l’APA à domicile versée aux personnes vivant chez elles
- l’APA en établissement versée aux personnes hébergées en établissement.
Les règles d’attribution et les montants versés ne sont pas les mêmes.
Si une personne perçoit l’APA à domicile, elle continuera à toucher l'APA en établissement. Cette allocation lui permettra de couvrir une partie de la facture.
A noter : son niveau de GIR est susceptible de changer. En effet, le GIR est réévalué après l’entrée en établissement.
Si vous êtes locataire d’un logement en résidence services et que vous êtes une personne âgée en situation de perte d’autonomie, vous pouvez à vos frais faire des travaux d’adaptation de votre logement. Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour réaliser ces travaux d’adaptation de votre logement.
Oui, il est possible de faire plusieurs demandes d’admission dans des EHPAD différents.
Tous les établissements utilisent un dossier national unique de demande d’admission en EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Si vous faites votre demande en ligne :
- vous créez un dossier de demande d'admission sur le service en ligne ViaTrajectoire,
- vous remplissez une seule fois le dossier,
- et vous l'envoyez en un seul clic à plusieurs établissements.
Si vous faites votre demande par courrier :
- vous téléchargez et imprimez le formulaire unique de demande d'admission temporaire ou permanente en EHPAD,
- vous remplissez une seule fois le dossier,
- vous pouvez transmettre des photocopies de ce dossier unique de demande d’admission aux différents EHPAD que vous avez sélectionnés.
Dans la quasi totalité des départements, la demande d’admission en EHPAD se fait avec le service en ligne ViaTrajectoire.
Pour savoir si ce service est disponible dans un établissement, recherchez l'EHPAD pour lequel vous souhaitez faire une demande d'admission dans l'annuaire en ligne du portail. Consultez ensuite sa fiche détaillée :
- si l'établissement se situe dans un département proposant la démarche en ligne, un lien est proposé vers ViaTrajectoire ;
- sinon, vous devez utiliser le formulaire unique de demande d'admission temporaire ou permanente en EHPAD - Cerfa n°14732*03 à remplir et à envoyer.
Le dossier de demande d'admission en EHPAD comporte un volet administratif et un volet médical. Le volet administratif est à compléter par la personne âgée ou par une personne de son entourage. Le volet médical doit être rempli par le médecin traitant.
Vous pouvez retirer le dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement auprès de votre CCAS (centre communal d’action sociale) ou auprès de votre mairie.
Bien entendu, il est tout à fait possible de rendre visite à votre proche en maison de retraite lorsque vous le souhaitez. Néanmoins, il faut tenir compte de certains impératifs horaires afin de profiter au mieux de votre visite :
- Éviter si possible les visites trop tôt le matin : c'est généralement le moment de la journée où sont prodigués les soins et vous risquez également d'arriver pendant la toilette.
- Éviter les horaires des repas, vous risqueriez de perturber le service ; cependant, beaucoup de résidences proposent des repas invités (il suffit généralement de prévenir 24h ou 48h avant).
A part ces deux moments de la journée qu'il est préférable d'éviter, vous êtes totalement libre de rendre visite à votre proche, sans avoir à prévenir. Assurez-vous toutefois auprès de votre proche ou de l'équipe de la maison de retraite que rien n’empêche cette visite car il peut il y avoir une animation, le passage du coiffeur ou une sortie programmée etc.
C’est au titre de l’obligation alimentaire, qui est l’obligation d’aider matériellement des personnes de sa famille lorsque ces dernières sont dans le besoin, que les gendres ou belles-filles peuvent être sollicités pour participer aux frais d’hébergement de leurs beaux-parents.
Un gendre ou une belle-fille n’est plus obligé alimentaire de ses beaux-parents si son époux ou épouse ainsi que les enfants issus du mariage sont décédés. Une veuve sans enfants n’est plus l’obligée alimentaire de ses beaux-parents.
En France, 42 régimes de retraite coexistent. Ils sont le fruit de l’histoire et des acquis sociaux obtenus par différents corps de métier.
La réforme du régime général des retraites est entrée en application au 1er septembre 2023. Cette réforme modifie les conditions du départ en retraite, selon l’année de naissance.
Ainsi, l’âge légal d’ouverture des droits recule progressivement de 62 ans, pour les personnes nées avant le 1er septembre 1961 à 64 ans pour la génération née en 1968.
Ce recul de l’âge légal est progressif avec un recul de 3 mois par génération. La première génération touchée est celle née à compter du 1er septembre 1961 avec un départ qui ne pourra pas intervenir avant 62 ans et 3 mois.
Cependant, des dispositifs de départ anticipé existent pour les personnes ayant commencé à travailler jeunes et remplissant les conditions de carrière longue.
Il n’y a pas de durée de carrière minimale. Seul le critère d’âge limite votre accès au droit à la retraite. Cependant, pour toucher une retraite pleine, autrement dit à taux plein, vous devrez remplir un certain nombre de conditions. En effet, le taux plein est atteint soit automatiquement à 67 ans quelle que soit la durée de carrière, soit dès que la durée de carrière requise est atteinte, entre l’âge d’ouverture des droits et 67 ans.
La réforme du régime général entrée en application le 1er septembre 2023, modifie les durées de carrières requises pour les générations nées à compter du 1er septembre 1961. L’allongement prévu par la précédente réforme est accéléré. Elle passe ainsi de 168 à 169 trimestres pour les assurés nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1962. Puis 170 trimestres pour la génération née en 1963 et 171 pour celles et ceux nés en 1964. Pour atteindre 172 trimestres dès la génération née en 1965 au lieu de la génération née en 1973 tel que prévu par la précédente réforme.
Si ces durées de carrières ne sont pas atteintes, une minoration sera appliquée lors du calcul de votre retraite. La décote maximale appliquée est de 20 trimestres. La retraite est dans ce cas calculée avec un taux de 37,5 % au lieu de 50 %.
Le calcul de la retraite de base des salariés dépend de 3 facteurs. Le montant de votre retraite sera, d’une part, calculé sur la base de vos 25 meilleures années (SAM : Salaire Annuel Moyen). D’autre part, il sera calculé au taux plein si vous remplissez les conditions d’attribution. Sinon, le taux appliqué au calcul de votre retraite sera minoré. Enfin, le calcul dépendra du nombre trimestres validés et du nombre de trimestres requis selon votre année de naissance.
La formule de calcul à retenir est donc : SAM x Taux x Nombre de trimestres validés / Nombre de trimestres requis
Le SAM n’est pas toujours calculé à partir des salaires réels. Il est, en effet, plafonné à un montant défini tous les ans. Par exemple, en 2024, le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) est de 46 368 €. Si votre salaire annuel au cours de votre carrière a dépassé le PASS, votre SAM sera limité à ce plafond.
À la retraite de base s’ajoute la retraite complémentaire dont le calcul est beaucoup plus simple. Il vous suffit de multiplier vos points acquis par la valeur de service du point, chaque année. Attention, si vous n’atteignez pas le taux plein dans le régime de base, vous subirez également une décote sur votre retraite complémentaire.
Les règles de calcul et d’obtention des retraites sont plus ou moins spécifiques à chaque régime.
- Le départ anticipé pour carrière longue : la condition de durée de carrière est assouplie et de nouvelles bornes d’âge étendent l’accès au dispositif.
- L’accès à la retraite progressive est étendu aux professions libérales et aux fonctionnaires. Cependant, le recul de l’âge légal de départ en retraite aura un impact sur l’éligibilité au dispositif pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961. En effet, l’âge du départ en retraite progressive recule de 60 ans à 3 mois à 62 ans, à raison de 3 mois par génération.
- Le cumul emploi-retraite qui permet de toucher ses retraites et de continuer à travailler devient productif de nouveaux droits à condition d’avoir atteint l’âge d’ouverture des droits (sauf dispositif carrière longue), de justifier du nombre de trimestres requis pour bénéficier du taux plein et d’avoir liquidé l’ensemble de ses retraites françaises et étrangères.
Attention, tous les régimes complémentaires ne se sont pas alignés concernant le cumul emploi-retraite.
Les rachats de trimestres devenus inutiles par la réforme des retraites, seront remboursés sur demande.
Pour le système de retraite par répartition, les cotisations, versées par les actifs au titre de l’assurance vieillesse, sont utilisées au même moment pour payer les pensions des retraités. Grâce aux cotisations qu'ils versent, les actifs acquièrent des droits qui leur permettront, à leur tour, de bénéficier d'une pension de retraite financée par les générations d'actifs suivantes.
Le système de retraite français est un système fondé sur la répartition. Il a été mis en place par les ordonnances de 1945 créant la sécurité sociale, afin d’assurer à tous les affiliés un certain niveau de ressources, une fois à la retraite. Il s’applique pour l’ensemble des régimes obligatoires de retraite de base ou complémentaire.
Le système par répartition est donc basé sur une solidarité intergénérationnelle. Il repose également sur une solidarité fondée sur des critères socio-professionnels, ce qui a structuré l’organisation du système de retraite en plusieurs régimes.
Des professionnels libéraux de santé et des services autonomie à domicile peuvent intervenir à la demande des occupants.
Pour le système de retraite par répartition, les cotisations, versées par les actifs au titre de l’assurance vieillesse, sont utilisées au même moment pour payer les pensions des retraités. Grâce aux cotisations qu'ils versent, les actifs acquièrent des droits qui leur permettront, à leur tour, de bénéficier d'une pension de retraite financée par les générations d'actifs suivantes.
Le système de retraite français est un système fondé sur la répartition. Il a été mis en place par les ordonnances de 1945 créant la sécurité sociale, afin d’assurer à tous les affiliés un certain niveau de ressources, une fois à la retraite. Il s’applique pour l’ensemble des régimes obligatoires de retraite de base ou complémentaire.
Le système par répartition est donc basé sur une solidarité intergénérationnelle. Il repose également sur une solidarité fondée sur des critères socio-professionnels, ce qui a structuré l’organisation du système de retraite en plusieurs régimes.
Des professionnels libéraux de santé et des services autonomie à domicile peuvent intervenir à la demande des occupants.
Pour le système de retraite par répartition, les cotisations, versées par les actifs au titre de l’assurance vieillesse, sont utilisées au même moment pour payer les pensions des retraités. Grâce aux cotisations qu'ils versent, les actifs acquièrent des droits qui leur permettront, à leur tour, de bénéficier d'une pension de retraite financée par les générations d'actifs suivantes.
Le système de retraite français est un système fondé sur la répartition. Il a été mis en place par les ordonnances de 1945 créant la sécurité sociale, afin d’assurer à tous les affiliés un certain niveau de ressources, une fois à la retraite. Il s’applique pour l’ensemble des régimes obligatoires de retraite de base ou complémentaire.
Le système par répartition est donc basé sur une solidarité intergénérationnelle. Il repose également sur une solidarité fondée sur des critères socio-professionnels, ce qui a structuré l’organisation du système de retraite en plusieurs régimes.
Des professionnels libéraux de santé et des services autonomie à domicile peuvent intervenir à la demande des occupants.
La retraite par capitalisation fonctionne sur le principe de l'épargne.
Les actifs cotisent pour leur propre retraite. Leurs cotisations font l’objet de placements financiers ou immobiliers, dont le rendement est tributaire des taux d’intérêt. Cette capitalisation peut être effectuée par les individus eux-mêmes ou par les entreprises pour leurs salariés.
Les premières assurances sociales mises en place reposaient sur un système par capitalisation (loi de 1910 dite des retraites ouvrières et paysannes et lois de 1928 et 1930). Toutefois, ce système a été abandonné au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La grande inflation puis la crise des marchés des capitaux avaient mis à mal la confiance dans l’épargne individuelle.
Pour certains, la plus grosse faiblesse des systèmes par la capitalisation est le risque. La capitalisation est sensible aux aléas des marchés boursiers. D'autres considèrent que la répartition et la capitalisation peuvent être complémentaires. La plupart des pays européens ont introduit une part de capitalisation dans leurs systèmes de retraite.
Des professionnels libéraux de santé et des services autonomie à domicile peuvent intervenir à la demande des occupants.
Vous ne toucherez pas une seule retraite mais plusieurs.
Lorsque vous avez travaillé en France, vous avez obligatoirement cotisé auprès d’un régime de base (le régime général pour les salariés) et d’un régime complémentaire (l’Agirc-Arrco pour les salariés du privé). Même si vous avez cessé de cotiser en France depuis de nombreuses années, vous aurez droit à ces retraites le moment venu. Ne les oubliez pas !
Il en sera de même dans l’ensemble des pays dans lesquels vous avez cotisé. Chaque pays versera en effet sa part en fonction de votre durée de carrière et de cotisation dans chacun des pays.
Si vous avez sillonné le monde, faites le point sur l’ensemble de vos retraites. Et n’oubliez pas les régimes de retraite par capitalisation ou retraites supplémentaires d’entreprise.
Selon votre pays d’expatriation, le calcul de vos retraites pourra répondre à des règles différentes, en fonction des accords ou conventions bilatérales signées par la France.
La mesure phare de la réforme des retraites de 2023 est le recul de l’âge de départ à 64 ans. C’est la génération née en 1968 qui sera la première à partir à cet âge. Les assurés ne pourront pas demander leurs retraites avant cet âge, sauf s’ils ont commencé à travailler tôt et remplissent les conditions pour bénéficier d’un départ anticipé pour carrière longue.
Les générations précédentes auront vu leur âge de part reculer progressivement de 62 ans à 64 ans, à raison de 3 mois par génération.
Les résidences services ne disposent pas de personnel soignant salariés de la résidence services (médecin, infirmier, aide-soignant…). Contrairement aux EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), ces résidences services sont destinées aux personnes âgées autonomes ou relativement autonomes qui souhaitent vivre dans un cadre sécurisé avec des services adaptés à leurs besoins.
Des professionnels libéraux de santé et des services autonomie à domicile peuvent intervenir à la demande des occupants.
Il existe un site officiel qui est le portail national d'information et d'orientation des personnes âgées en perte d'autonomie et de leurs proches, édité et animé par le Service public de l'autonomie.
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
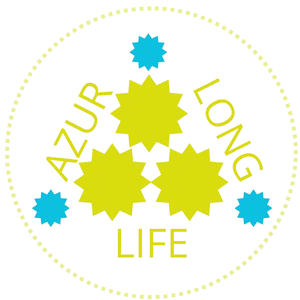
L’assuré acquiert des trimestres en cotisant.
La validation des trimestres dépend du salaire brut obtenu chaque année. Pour valider 1 trimestre, il faut avoir gagné l’équivalent de 150 fois le Smic horaire (minimum trimestriel). Pour valider 4 trimestres en 2023, il vous suffira donc de cotiser sur un revenu annuel de 6 912 €. Il peut alors suffire de travailler quelques mois dans une année pour valider 4 trimestres si vos revenus sont élevés.
L’obtention des trimestres de retraite n’est, en effet, pas liée à une durée de travail exprimée en mois. À l’exception de l’année du départ en retraite ! Il vous faudra attendre, cette année-là, la fin de chaque trimestre pour l’engranger.
L’année du départ en retraite, deux conditions sont donc à remplir pour valider 4 trimestres : il faut avoir cotisé au minimum sur un revenu annuel de 600 fois le Smic horaire et attendre le 1er janvier. Ce qui n’implique pas d’avoir travaillé jusqu’au 31 décembre. Subtil, non ?
Exemple de l’année de la liquidation des droits, durant laquelle il n’est pas possible de valider plus de trimestres que le nombre de trimestres calendaires écoulés entre le 1er janvier et la date d’effet des retraites.
Michel est né le 5 mars 1962, il devra attendre le 1er octobre 2024 soit 62 ans et 6 mois pour demander ses retraites. Au 31 décembre 2023, il justifie de 165 trimestres. Il cotise sur un salaire supérieur au plafond qui lui permet de valider 4 trimestres supplémentaires dès le 1er avril 2024.
Néanmoins, s’il demande ses retraites le 1er octobre 2024, seuls 3 trimestres seront pris en compte au titre de 2024. Avec seulement 168 trimestres (165 + 3), il lui manquera un trimestre et il n’aura pas droit à une retraite à taux plein.
Exception : certains régimes spéciaux, notamment la Fonction Publique, valident des trimestres au titre de la durée d’activité : 90 jours de cotisation en tant que fonctionnaire permettent de valider 1 trimestre.
Certains événements de la vie permettent par ailleurs de valider des trimestres qui n’ont pas donné lieu à cotisation. La naissance d’un enfant permet à la mère biologique de valider 4 trimestres pour chaque enfant. Il en est de même pour un des parents en cas d’adoption. L’éducation d’un enfant, jusqu’à ses 4 ans, permet sous conditions, de valider 4 trimestres éventuellement partageables entre les deux parents si l’enfant est né à partir de 2010. Le service militaire : toute période commencée de 90 jours valide 1 trimestre. Le chômage : 50 jours valident 1 trimestre. Les arrêts pour longue maladie : 60 jours d’arrêt permettent de valider 1 trimestre.
Par ailleurs, les cotisations auprès de régimes de retraite étrangers ayant signé un accord de sécurité sociale avec la France permettent, sous conditions, de valider des trimestres.